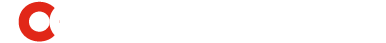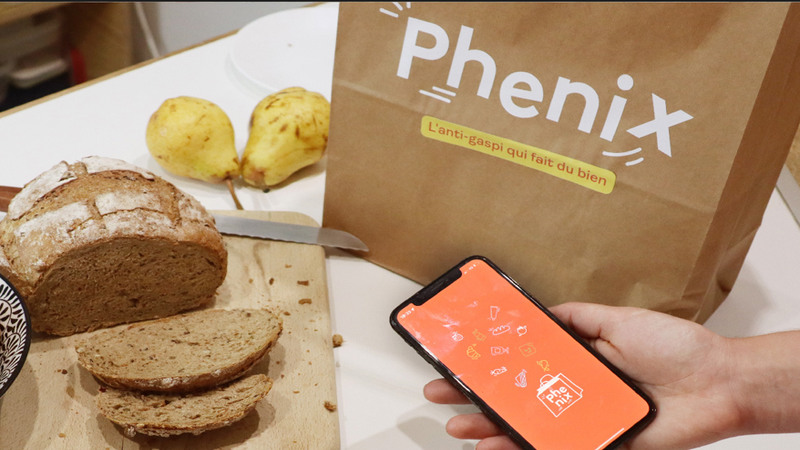Partenaire du Sommet de la mesure d'impact, organisé par Impact Tank, qui se tiendra le 18 avril prochain au Conseil économique social et environnemental, 100 Transitions met un coup de projecteur sur certains de ses intervenants phares. Cinquième volet de cette série : Philippe Peyrat, délégué général de la Fondation ENGIE.
Pouvez-vous nous présenter la Fondation Engie, ainsi que le périmètre de vos missions ?
La Fondation Engie a été l’une des toutes premières Fondations d’entreprise créées en 1992, sur deux grands engagements la protection de l’environnement et l’accès à la culture. Nous menons actuellement notre septième mandat : 2020- 2025. La Fondation se positionne aujourd’hui sur deux grands pôles : Nature et For people. Le premier représente l’ensemble de notre portefeuille consacré à la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique. Le Groupe a une vision forte : les questions de lutte contre le réchauffement climatique et de protection de la biodiversité sont indissociables et liées. Le second comporte deux volets : l’éducation et la lutte contre la précarité. Nous nous sommes positionnés sur une grande cause sociale : la place des femmes (lutte contre les violences et la précarité, accès des filles aux filières scientifiques). Notre exigence: prendre soin de la vie et de notre planète, répondre aux besoins des populations fragilisées ou éloignées.
La question de l’engagement des collaborateurs est centrale, avec l’appui à nos ONG internes. Les employés d’ENGIE se sont spontanément mobilisés en créant début 2000, il y a plus de 20 ans, des associations, baptisées Énergie Assistance, pour apporter une énergie renouvelable aux populations les plus vulnérables. Nous accompagnons et aidons ces actions un peu partout dans le monde, dans le cadre d’un plan stratégique : qui vise 1 million de bénéficiaires à la fin du mandat, la parité dans nos équipes de volontaires, une déclinaison biodiversité, la formation d’équipes locales. Cette semaine par exemple, une de nos missions part à Madagascar pour électrifier un dispensaire et nous emmenons au Sénégal une dizaine d’élèves d’un lycée professionnel niçois afin d’électrifier deux collèges avec des lycéens du lycée Malafosse de Dakar. C’est une originalité et une force pour ENGIE.
Nous sommes une fondation distributive et non pas opérative ; cette année nous accompagnerons 139 projets. Parmi ceux-ci, 63 sont consacrés à l’éducation, 37 à la biodiversité et 39 à la lutte contre la précarité. Au total, cela représente cette année 148 000 bénéficiaires.
Nous inscrivons notre action dans la raison d’être d’ENGIE : celle d’accompagner la transition vers une économie zéro carbone, avec l’idée d’une transition abordable, désirable, accessible et partagée.
Pour ma part, je suis délégué général de la fondation depuis 8 ans. J’ai été en charge lors de la fusion Suez – Gaz de France de mettre en place une politique partenariats – engagements – philanthropie cohérente, avec la mise en place de la Fondation ENGIE. Nous avons piloté un changement d’échelle et d’ambition de la Fondation avec un mandat de 5 ans et un budget de 39 millions. Auparavant, je pilotais la politique de partenariats du groupe Suez, qui disposait aussi d’une petite fondation. Nous étions tout particulièrement impliqués dans les partenariats liés au sport, avec dès le début une forte dimension solidaire. C’était original pour l’époque, car le sponsoring mettait surtout l’accent sur la visibilité de la marque. Nous déclinions pour notre part un volet solidarité et engagement.
Comment intégrez-vous la notion d’impact dans vos activités ?
La notion d’impact est pour nous un enjeu fort, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous participons au Sommet et sommes heureux de prendre part aux groupes de travail du Groupe SOS, pour l’égalité des chances notamment. C’est une exigence pour mesurer l’efficacité. Pour chaque projet, nous menons une politique de mesure d’impact. Avant qu’ils ne valident les projets, le comité de sélection et le conseil d’administration ont prévu une série de questions sur l’impact et les objectifs fixés. Ensuite, des mesures sont prises à moyen terme afin de vérifier que les peuvent bien être atteints, mais aussi après les premières années de mise en place, pour déterminer si le partenariat peut continuer ou s’il a besoin d’être ajusté.
À lire aussi Sommet de la Mesure d’impact, une seconde édition pour changer le système !
Pour nous, la mesure d’impact s’évalue selon trois dimensions. La première relève de l’impact sur les bénéficiaires, direct et indirect. La seconde tient à l’impact de l’action sur la structure porteuse et si cela lui permet de se développer. Doit-elle envisager un changement d’échelle ? La troisième dimension, qui nous tient à cœur, a trait à l’interaction du projet et de la structure avec le groupe ou la fondation. Les collaborateurs peuvent-ils s’associer ? Pouvons-nous apprendre des choses et nous nourrir mutuellement ? Ce sont ces 3 dimensions qui définissent la performance philanthropique d’un projet.
Un bon exemple de ce genre d’interaction est la plateforme de mentorat que le groupe a montée et qui permet aux collaborateurs de suivre et de soutenir au plus près les projets que nous sélectionnons.
Quels outils de mesure d’impact avez-vous mis en place ?
Ils varient selon les sujets. Pour ce qui est du champ social pour l’enfance par exemple, nous avons des instruments de plus en plus fins, qui mesurent l’absentéisme, l’intérêt des élèves, leur capacité à interagir les uns avec les autres, leur confiance en eux… C’est très riche et assez précis pour bien évaluer ce type de projets.
Mais il faut aussi garder à l’esprit que les 139 projets de notre portefeuille ne sont pas tous au même niveau sur le sujet. Certains, très en avance sur ces questions, ont bénéficié de mécénat de compétences et des conseils d’organismes spécialisés. À l’opposé, certaines structures se sont moins bien emparées du sujet et peuvent avoir besoin d’aide. Il y a donc un enjeu important à moyen et long terme en ce qui concerne la diffusion de cette culture d’impact : c’est le rôle aussi de nos Fondations. Un besoin de standardisation est présent, tout particulièrement pour les projets qui bénéficient de multiples soutiens internationaux. Les ONG font face à des demandes de reporting très différentes selon les bailleurs… Ce scénario concerne tout particulièrement les fondations, puisque nous agissons souvent en coalition.
"Nous devons faire preuve de tolérance vis-à-vis des associations"
Je voudrais aussi souligner le fait que nous devons faire preuve de tolérance vis-à-vis des associations. Elles ont souvent des moyens limités pour mener à bien leurs actions, et la mesure d’impact peut représenter une mobilisation de temps et de main-d’œuvre. Il ne faut pas perdre de vue la réalité du tissu associatif et garder à l’esprit que ces associations n’ont pas les moyens des grandes entreprises. Les associations nous disent : « Pour 5 000 ou 10 000 €, je ne peux pas remplir un questionnaire de 40 pages, avec tout le temps perdu que cela implique pour les équipes, alors que notre rôle est d’agir sur le terrain ».
Afin d’aider ces acteurs à adopter ces pratiques, la mise en place de budgets d’accompagnement pour financer cette mesure d’impact peut être une solution. Au point d’ailleurs que ce financement peut égaler celui du budget initial, mais cela peut valoir le coup, ne serait-ce que pour vérifier que l’argent est « bien » dépensé et aide à la prise de décision.
D’une manière générale, nous devons aussi garder une certaine flexibilité, car les besoins peuvent évoluer très rapidement, en particulier quand il s’agit d’exclusion sociale. Il faut réussir à trouver un équilibre entre l’envie de planifier très en avance et la réalité, afin de préserver une capacité d’adaptation pour répondre aux besoins changeants des partenaires.
Vous participerez le 18 avril au Sommet de la mesure d’impact. Pourquoi soutenir cet événement et quel message allez-vous y porter ?
À mon sens, une des grandes problématiques à l’heure actuelle réside dans le besoin d’élaborer une culture commune de l’impact. Pour le moment, tous les acteurs ont tendance à travailler dans leur coin, et nous devons partager davantage entre nous. Beaucoup d’acteurs font de belles choses et sont satisfaits de leurs programmes, mais ne vont pas voir ce que font leurs homologues. C’est pour cela que le Sommet est une initiative qui nous est chère, car elle nous permet d’échanger avec de très nombreux autres acteurs. Ce sera une journée très riche en interactions ! Pour notre part, nous réunissons ainsi régulièrement nos partenaires pour qu’ils partagent.
À lire aussi "La mesure d’impact : un nouveau paradigme pour changer le système"
Il y a aussi une exigence que soulignait Agnès Audier: nous sommes concentrés sur la transition environnementale, économique et industrielle vers des modèles plus vertueux, mais il ne faut pas passer à côté de la transition sociale. Toutes ces transformations peuvent créer des inégalités, et nous devons déterminer comment nous allons lutter contre elles. La transition est au cœur du projet d’ENGIE. C’est un marqueur d’identité et d’ambition.
Propos recueillis par François Arias